Le tronc
I. Se pencher en avant
La partie lombale est un rassemblement conjonctif de tissu fibreux. C'est la partie caudale des érecteurs.
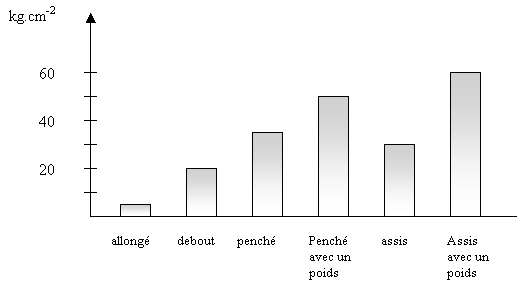
Histogramme représentant la force subie par le disque
intervertébral
Les extenseurs du rachis
Les extenseurs sont au nombre de trois, ce sont trois longs muscles, de chaque côté de l'axe vertébral.
De dehors en dedans :
- l'ilio-costal
- le longissimus (long dorsal)
- l'épiépineux
Ils redressent le tronc lorsqu'il est penché en avant. Ils sont freinateurs du déséquilibre antérieur du tronc. Ils ont une origine commune sur le bassin et la région lombale : la partie caudale des érecteurs. Cette origine est fibreuse, conjonctive, directement plaquée en arrière des vertèbres.
L'ilio-costal
(1)
C'est le plus latéral des extenseurs. Constitué de trois parties.
-
lombale
tendue entre la crête sacrée et iliaque jusqu'aux neuf dernières côtes
-
thoracique
tendue entre les six dernières côtes jusqu'aux six premières
-
cervicale
tendue entre les côtes moyennes (4 à 7) jusqu'aux vertèbres cervicales inférieures (4 dernières).
Longissimus
Origine : crête sacrée et iliaque, plus les cinq vertèbres lombales
Trajet : vers le haut. Il est en dedans de l'ilio-costal
Terminaison : sur toute la hauteur du thorax, à la fois sur les 12 vertèbres thoraciques et sur les côtes.
L'épiépineux
C'est le plus en dedans
Origine : troisième vertèbres lombale à la 11e vertèbre thoracique
Trajet : vers le haut
Terminaison : de la troisième vertèbre thoracique à la 9e.
Ces trois muscles sont extenseurs.
II. La lutte de la pesanteur
Fait appel aux érecteurs. Ils luttent contre l'accentuation des courbures du dos. 80 % des informations sont d'origine visuelles.
Le transversaire épineux
Composé de 4 faisceaux répartis en 2 sous-groupes :
- les rotateurs : comprenant 2 muscles, le court et le long rotateur
- les multifides : un muscle court et un muscle long
Il n'est pas symétrique
Origine : chaque étage vertébral sur le processus épineux
Trajet : vers le bas
Terminaison : les 4 faisceaux se dirigent sur les 4 vertèbres sous-jacentes
Le court rotateur
Origine : sur le processus transverse de la vertèbre V-1
Trajet : en dehors
Terminaison : sur l'apophyse épineuse de la vertèbre V
Le long rotateur
Origine : sur le processus transverse de la vertèbre V-2
Trajet : en haut
Terminaison : sur l'apophyse épineuse de la vertèbre V
Le court multifide
Origine : sur le processus transverse de la vertèbre V-3
Trajet : en haut
Terminaison : sur l'apophyse épineuse de la vertèbre V
Le long multifide
Origine : sur le processus transverse de la vertèbre V-4
Trajet : en haut
Terminaison : sur l'apophyse épineuse de la vertèbre V
Action : diminuer les courbures rachidiennes
III. Le tronc
On y retrouve toute la colonne vertébrale en arrière.
La courbure lombale avec 5 vertèbres. Elle est concave vers l'arrière.
La courbure thoracique avec 12 vertèbres. Elle est convexe vers l'arrière.
La courbure cervicale avec 7 vertèbres. Elle est concave vers l'arrière.
Total : 24 vertèbres en ajoutant le sacrum (5 vertèbres soudées) et le coccyx.
La partie thoracique est formée par les vertèbres thoraciques en
arrière, 12 paires de côtes placées latéralement, et le sternum en avant. Ce
caisson thoracique renferme des organes vitaux. Ce qui explique le grill
costal.
On dit qu'il y a 7 vraies paires de côte, car chacune de ces côtes possèdent une articulation avec le sternum en avant. Il y a 3 fausses paires (8, 9, 10) car elles possèdent le même cartilage avec le sternum en avant. Il y a 2 paires de côte flottantes (11, 12) car elles possèdent une origine vertébrale mais se terminent latéralement au flan. Leur terminaison est libre.
Il y a 3 articulations : 2 entre la côte et la vertèbre thoracique, et une avec le sternum.
Avec le sternum, cela se termine par un cartilage costal.
Dans ce caisson thoracique, on note 3 muscles intercostaux
tendus entre chaque espace intercostal. Ils sont inspirateurs et expirateurs
accessoires. Leur fonction est d'assurer la transmission des forces entre les
épaules et le bassin, et solidifient les parties thoraciques. Le caisson
thoracique est compressible.
Le caisson abdominal
Les parois sont musculaires, car cela permet les mouvements du thorax sur le bassin et inversement. Le contenu est liquidien (non compressible). La poutre composite est l'activité musculaire du caisson abdominal. Les parois sont déformables (grossesse).
On note 6 parois.
La paroi inférieure
Appelé le plancher pelvien.
Ces muscles ont pour rôle de soutenir les organes du petit bassin (notamment les organes sexués). Tous ces muscles sont des muscles qui travaillent en permanence et subissent d'énormes contraintes.
·
Le muscle élévateur de l'anus
Muscle en forme d'entonnoir à sommet inférieur. Formé de 2 faisceaux : un médial (pubien) et un latéral (iliaque). Ils se terminent tous les deux par des fibres pré et rétro rectal. Ils se continuent par le même muscle controlatéral.
-
le faisceau pubo-rectal (médial)
Il est tendu entre le corps du pubis et le rectum
-
le faisceau ilio-rectal (latéral)
Tendu entre le pubis et l'épine sciatique de l'os coxal. Sa terminaison est la même, au niveau du rectum.
Le rôle de ce muscle est l'élévation de l'anus, et le rôle d'hamac du plancher pelvien.
·
Le transverse du périnée
·
L'ischio-caverneux
·
L'ischio-coccygien
La paroi antérieure
Les muscles droits de l'abdomen
Tendus entre le thorax et le pubis.
Origine : sur les 5e, 6e, et 7e arcs costaux
Trajet : vertical en bas. les fibres sont entrecoupées de lamelles conjonctives (comme du tendon). Ils sont entourés par une gaine leur conférant une rigidité.
Terminaison : sur le pubis en continuité avec les adducteurs de hanche.
Action : abaissent le thorax (contractent). Ils rétroversent le bassin. Ils font les 2 ensemble.
La ligne blanche
Lame aponévrotique partant du sternum, se dirige vers le bas. sert d'ancrage aux muscles abdominaux. En son centre, on trouve le nombril lombilique. Se termine au pubis.
La paroi latérale.
Le transverse
Origine : sur les 6 dernières côtes (les 5 lombales plus la crête iliaque)
Trajet : toutes les fibres sont horizontales, en dehors puis en avant et en dedans
Terminaison : en avant sur la ligne blanche
Action : muscle du "rentré de ventre"
Les 2 transverses forment une ceinture qui fait rentrer le ventre.
L'oblique externe (grand oblique)
Origine : sur les 7 dernières côtes et la crête iliaque.
Trajet : en éventail, direction oblique en bas, en dehors et en arrière
Terminaison : du ligament inguinal au pubis, et sur la ligne blanche. Il se poursuit par l'oblique interne controlatéral.
Action : incline du même côté. Il est inclinateur homolatéral du thorax sur le bassin. Effectue une rotation controlatérale. Projette vers l'avant le thorax par rapport au bassin.
L'oblique interne (petit oblique)
Origine : sur le bassin (os coxal) et le ligament inguinal
Trajet : en haut et en dedans
Terminaison : 3 dernières côtes et la ligne blanche. Se poursuit par l'oblique externe controlatéral.
Action : en unilatéral, entraîne une élévation du bassin et une rotation controlatérale. En bilatéral, ces muscles diminuent la courbure lombale (rétroversion.)
La paroi postérieure
Carré des lombes
Ce muscle est plaqué latéralement au rachis. Un à droite, un à gauche. Sert de protection latérale à la colonne lombale. Situé entre la 12e côte en haut, les 5 vertèbres lombales en médial, et la crête iliaque en bas.
On lui distingue 3 faisceaux. Un ilio-costal. Un costo-transversaire. Un ilio-transversaire.
Son action est de protéger la colonne vertébrale.
Le psoas
Origine : corps vertébraux des 5 vertèbres lombales et sur les disques intervertébraux.
Trajet : en bas, en dehors et en avant. Il est rejoint au niveau du bassin par le muscle iliaque. Ces 2 muscles passent en arrière du ligament inguinal.
Terminaison : sur le petit trochanter (extrémité supérieure du fémur)
Action : si le fémur est fixe, il entraîne une antéversion du bassin. Si les vertèbres sont fixes, il fléchit le fémur par rapport au bassin. Il lutte contre la courbure lombale.
La paroi supérieure
Elle est composée du muscle diaphragme, qui est une nappe musculaire qui sépare le caisson abdominal (liquidien) du caisson thoracique (gazeux). Ce muscle est le muscle inspirateur.
Le diaphragme
Composé de 2 parties : un centre qui est une nappe tendineuse, c'est le centre phrénique; et une partie périphérique qui entoure ce centre phrénique constitué de fibres musculaires.
Ces fibres vont s'attacher en avant sur le sternum, latéralement sur les côtes. En arrière, ces fibres musculaires vont s'attacher sur les corps vertébraux.
Sur le corps vertébral, les fibres musculaires descendent par le pilier principal qui descend sur les 4 vertèbres lombales, et le pilier accessoire qui va s'insérer sur les 2 premières.
L'action de ce muscle est le muscle inspirateur. Cette inspiration se fait en 3 temps.
Les fibres musculaires se contractent et entraînent un abaissement du centre phrénique.
Le centre phrénique prend appui sur les viscères.
Le centre phrénique devient point fixe.
Puis il y a élévation des côtes.
Le centre phrénique protège le passage des gros vaisseaux (œsophage, aorte…)