
Télécharger CM 1 Motricite et Connaissance(Sur ce lien, clic droit puis enregister la cible sous...)
D.E.U.G. 2ème année
La mémoire
(3CM, 1TD)

Télécharger CM 1 Motricite et Connaissance(Sur ce lien, clic droit puis enregister la cible sous...)
D.E.U.G. 2ème année
La mémoire
(3CM, 1TD)
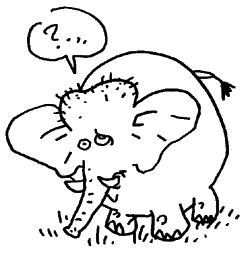
________________________________________________________________________
|
2003
– 2004 |
Yves Kerlirzin |
Un homme va voir son docteur en se plaignant de trous de mémoire. Le docteur lui pose quelques questions de routine et lui dit : Alors ? Et ces lacunes ? – Quelles lacunes ? demande le patient.
O. Sacks, in
L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau
Le marin perdu, 41-64 (p.45).
Plan du cours
********
Ce cours repose sur 3 CM (6h) et 1 TD (2h)
Le Td a permis de travailler sur 2 articles
de La Recherche Spécial La mémoire et l'oubli, N°344, Juillet-Août 2001 :
"Je l'ai sur le bout de la langue" & "Le syndrome des faux
souvenirs", ainsi que sur le Syndrome de Korsakoff, encadré 27, pages
156-157 du Manuel de Psychologie, Eustache, F., Faure, S. (2000), Editions
Dunod.
Introduction – Définitions
I - Une mémoire ou des mémoires. La diversité.
1) La mémoire sensorielle
2) La mémoire à court terme
3) La mémoire à long terme
3.1. Trois processus
a) Encodage
b) Consolidation
c) Restitution, récupération
3.2 Mémoire procédurale ou implicite
3.3 Mémoire déclarative ou explicite
a) Episodique
b) Sémantique
II
– Les structures et les circuits de la
mémoire.
1) Plasticité neuronale et potentialisation
à long terme (LPT)
2) Le rôle de l'hippocampe
a) Un rôle essentiel dans la construction de la mémoire
b) Cellules de lieu et d'orientation
c) Une idée originale, suite logique
III
– L'oubli
IV- Un exemple de trouble de la mémoire : la maladie
d'Alzheimer
1) Définition
2) Symptômes
3) Lésions histologiques
a) les plaques séniles
b) la dégénérescence neurofibrillaire
c) l’atrophie corticale
4) Traitement
Le coin des curieux
Emprunts, références, sources
Introduction – Définitions
|
|
1ère hypothèse : notre ami est pensif, il utilise sa mémoire 2de hypothèse : notre ami interroge sa mémoire: ça me rappelle quelqu'un, mais qui ? |
Cette illustration nous rappelle que chacune ou chacun d'entre nous a un jour été confronté(e) à une mémoire momentanément défaillante ("je le savais", "ah, je l'ai sur le bout de la langue", "de quoi on parlait déjà ?"), à l'évocation de souvenir à l'occasion d'une musique, d'un parfum, d'un contexte particulier. Chacune et chacun d'entre nous tente également au quotidien de développer des stratégies singulières, d'utiliser au mieux sa mémoire pour se souvenir d'un rendez-vous ou d'une entrevue importante, ou bien encore pour conserver les données qui vont lui permettre de s'en tirer le mieux possible le jour du partiel. Tout cela, brièvement évoqué, nous rappelle l'importance particulière de la mémoire pour la plupart des individus. Elle est un élément essentiel, central, de la qualité de la vie. Elle assure au groupe social, par le biais d'une mémoire collective, son identité et sa cohésion.
Selon le Robert historique de la langue française, le terme mémoire est issu (1050) du latin mémoria qui désigne l'aptitude à se souvenir et également l'ensemble des souvenirs. Le mot est dérivé de memor, "qui se souvient". On peut définir ce terme comme la capacité à se souvenir, comme le souvenir lui-même (la re-présentation d'une personne, d'un lieu, d'un événement particulier), comme l'activité (le processus lui-même) qui permet la rétention. L'étude de la mémoire remonte au dix-neuvième siècle. Elle s'est développée en même temps que naissait ou se développait la psychologie scientifique (fin 19e – début 20e), et notamment l'étude de la perception. Hermann Ebbinghaus (1860-1909), chercheur allemand, est considéré comme l'auteur qui le premier a étudié la mémoire. S'inspirant des études menées sur la perception (et des travaux de Gustav Theodor Fechner, 1801-1887, l'inventeur de la psychophysique, avec probablement l'idée de chiffrer, de "mathématiser" ses résultats par l'énoncé de lois visant à établir les rapports entre la taille de la liste à mémoriser et le temps nécessaire à la fixer), il a développé et mis au point différentes méthodes expérimentales pour étudier l'acquisition et la conservation en mémoire de séries de syllabes sans signification, "comme VIX, PUJ, ZAR. Lui-même sujet de ses expériences, la série était apprise jusqu'à un critère de 2 répétitions sans erreur. Lorsqu'il pouvait effectivement répéter la série de syllabes 2 fois de suite sans erreur, il laissait s'écouler une certaine période de temps sans revoir ni répéter la série. Cette période pouvait varier entre 20 minutes et 30 jours. Après ce délai, il réapprenait la même série de syllabes jusqu'à ce qu'il atteigne le même critère, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau la répéter 2 fois sans erreur" (Fortin & Rousseau, 1989). Cherchant à déterminer ce qu'il restait de l'apprentissage initial, les travaux d'Ebbinghaus lui ont permis de révéler les différents facteurs intervenant dans la capacité des sujets à retenir des informations (e.g. la longueur de la liste de mots à apprendre, la durée de rétention, les effets de primauté et de récence –on retient mieux généralement sur une liste les premiers et les derniers éléments de cette liste, la capacité limitée de la mémoire immédiate –l'empan mnésique de George A. Miller, 1956). Ses expériences ont par ailleurs mis en évidence que même en cas d'oubli partiel ou total d'une liste déjà apprise, il était plus facile (i.e. besoin de moins de temps ou répétitions moins nombreuses) aux sujets à nouveau confrontés à la même tâche d'apprentissage de la même liste de l'apprendre à nouveau.
|
|
|
Courbe de l'oubli d'Ebbinghaus (1885) : l'oubli des
syllabes dénuées de sens est très rapide au cours des premières heures
suivant l'apprentissage. |
Comme le rappelle Jaffard (Pour la science), la mémoire est une fonction "intelligente". Elle est utile et nécessaire car elle permet aux hommes (et aux animaux) de se souvenir, de tirer des leçons du passé et de se bâtir une expérience permettant au moins l'adaptation ou la bonne réponse à la situation actuelle ou au plus tout simplement la survie. ". On dit souvent que quelqu'un qui ignore son histoire est condamnée à la revivre. La mémoire nous restitue notre passé, elle nous permet de mieux vivre notre présent et, d'une certain façon, de planifier ou de concevoir notre futur. Mais elle ne trouve pas seulement là son utilité. De façon concrète, elle est par exemple à l'œuvre dans les processus de simulation mentale utilisés par certains sportifs avant l'épreuve. Le skieur qui répète sa course avant la descente met à contribution sa mémoire de la configuration de la piste, avec les virages, les portes, les prises et les reprises d'appuis. On sait par ailleurs que la durée de cette simulation correspond à la durée réelle de l'épreuve (Droulez, 1991). Le skieur, faisant appel à son passé proche, est ainsi capable de s'imaginer, se construire, se projeter dans un futur proche.
Ce terme de mémoire fait appel à des processus complexes. On ne peut l'étudier indépendamment des autres fonctions cognitives telles que l'attention, la perception, la représentation, etc., l'ensemble permettant à l'individu de construire sa relation au monde. "Elle se manifeste dès les premières étapes de la perception. Pour reconnaître ou identifier les éléments présentés aux organes sensoriels, le sujet doit avoir déjà acquis un certain nombre de connaissances sur le monde. Les structures cognitives qui servent à comprendre et analyser l'environnement se construisent à partir de l'accumulation d'expériences avec l'environnement et sont conservées en mémoire permanente. Parallèlement, elles sont constamment remaniées et réorganisées par les nouvelles expériences. De même, pour exécuter une certaine action, il est nécessaire que le programme moteur de cette action soit enregistré en mémoire. On ne peut pas réaliser une nouvelle action sans qu'il y ait eu d'abord un apprentissage des mouvements qui la composent et de leur coordination. L'appréhension de toute situation nouvelle est fonction de la structure, du contenu et de l'organisation des informations apprises antérieurement. La mémoire permet donc de décrypter et d'analyser l'environnement immédiat. Aussi, est-il possible, grâce au contenu de la mémoire, des structures existantes, des expériences antérieures, d'interpréter et de réagir à des informations entièrement nouvelles. Cela fait de la mémoire une fonction indispensable à l'adaptation et à l'intelligence" (Combe-Pangaud, 2001).
On s'accorde généralement à décrire trois phases dans le processus
mnésique : une première phase d'apprentissage ou de fixation (l'acquisition, le
codage et le traitement de l'information, dirait un cognitiviste), une deuxième
phase de rétention ou de conservation (de stockage de l'information), puis une
troisième et dernière phase d'extraction ou de restitution (d'évocation, de
reconnaissance, de rappel de l'information). Selon Endel Tulving (1986), ces
trois processus sont entièrement distincts. Pour pouvoir
être conservée, l'information doit avoir au préalable été codée (ces codages
peuvent être de différentes natures : auditive, olfactive, sémantique,
visuelle, etc.). Ce sont ces paramètres de stockage qui vont permettre de
retrouver l'information. Ces activités mnésiques sont déterminantes dans
l'élaboration des activités cognitives (attention, perception, raisonnement,
résolution de problème).
Mémoriser, c'est donc pouvoir stocker des informations dans sa “ mémoire ” et être capable de les rappeler pour pouvoir les utiliser ultérieurement. Sans cette capacité, il n'est pas d'apprentissage possible. Cette mémorisation présente de nombreuses formes : elle peut porter sur un temps relativement court (conserver pendant quelques secondes le numéro de téléphone que l'on va composer) ou sur un temps plus long (l'élaboration et la conservation de connaissances). Chacun développe de ce point de vue, en fonction de son histoire et de ses caractéristiques, ses propres stratégies pour se bâtir sa mémoire. Nous y reviendrons.
Différents facteurs permettant le fonctionnement de la mémoire peuvent être évoqués.
- la motivation, le sens perçu (i.e. la compréhension) de la situation particulière dans laquelle se trouve l'individu. On sait bien qu'une personne motivée pour apprendre (le sujet la passionne, elle désire réussir) éprouve généralement plus de facilité pour "retenir" ce qu'elle apprend. On connaît tous quelqu'un capable de parler pendant des heures de l'histoire d'un sport particulier, les champions, les dates, les records, les anecdotes, etc.
- l'émotion ressentie (les premiers pas de l'homme sur la lune, la victoire de son équipe en phase finale de championnat), la valeur affective dédiée à certains événements, graves ou joyeux. La sensibilité particulière de chacun(e) est alors évidemment déterminante. L'état affectif du sujet peut faciliter ou inhiber les processus mnésiques (cf. les travaux de Freud).
- l'attention portée à l'événement, variable selon à la fois le degré d'implication personnelle ou affective de chacun et la compétence construite par le sujet pour lire cet événement (expert vs non expert), son pouvoir de concentration, l'abaissement de ses seuils de vigilance et de perception, de discrimination. La distance par rapport à l'événement peut également jouer un rôle important (la personne décide de façon délibérée d'inscrire en mémoire ce qui vient de se passer).
- enfin, le contexte. Nous savons que la construction de la personne est, à chaque instant et pas nécessairement de façon consciente, le fruit de stimulations et de l'intégration de différentes informations sensorielles (visuelles, auditives, olfactives, etc.). Comme le rappellent Fortin & Rousseau, (1989), "l'enregistrement sensoriel c'est ce qui vous met en contact avec le monde". Replacer quelqu'un dans un contexte particulier favorise généralement l'accès à sa mémoire, permet la reconstruction des relations qui ont permis à cette mémoire de se constituer.
I - Une mémoire ou des mémoires. La diversité.

Cheminement de l'information (du stimulus) dans les différentes
mémoires. Ce modèle sériel rappelle le modèle cognitif simplifié proposé par
Atkinson & Shiffrin en 1968 (modèle contesté actuellement).
La probabilité de l'existence de différentes mémoires, et notamment d'une mémoire à court terme et d'une mémoire à long terme à déjà été évoquée par Hebb en 1949. Alan Baddeley (1993) rappelle que "L’’emploi d’un concept unique pourrait suggérer que la mémoire est un système unitaire, bien qu'il soit aussi complexe que le cœur ou le foie. Comme nous le verrons, il n’y a pas un seul système mais plusieurs. Ces systèmes couvrent des durées de stockage allant de quelques fractions de seconde à la durée complète de la vie. Leur capacité de stockage varie de mémoires tampons (buffer) réduites, au système de mémoire à long terme dont la capacité excède largement celle de nos plus puissants ordinateurs."
William James distinguait déjà en 1890 deux composantes de la mémoire, une mémoire primaire ou immédiate, que l'on appelle aujourd'hui mémoire à court terme ou mémoire de travail, et une mémoire à long terme qui est "la connaissance d'un événement, d'un objet auquel nous avons un certain temps cessé de penser et qui revient, enrichie d'une conscience additionnelle, le signalant comme objet d'une pensée ou d'une expérience extérieure" (James, cité par Changeux, 1998).
Il existe donc non pas une mais des mémoires. La littérature s'accorde sur trois grands types ou systèmes de mémoire : la mémoire sensorielle (certains auteurs, comme Atkinson & Shiffrin, 1968, parlent de registre sensoriel), la mémoire à court terme et la mémoire à long terme.
1) La mémoire sensorielle
La mémoire sensorielle est en quelque sorte une mémoire automatique, instantanée, très éphémère, "presque assimilable à la perception" (Combe Pangaud). Sa durée varie selon la modalité sensorielle concernée (100 millisecondes environ pour la mémoire visuelle). En principe, à moins d'un déficit particulier, tous les événements vécus, toutes les informations qui parviennent à nos sens sont enregistrés, la plupart du temps sans même que nous en soyons nécessairement conscients. Cette mémoire est dotée d'une grande capacité. On suppose en effet que la mémoire sensorielle possède la capacité de percevoir stimuli que les différents capteurs sensoriels peuvent en recevoir (tout ce que l'oeil peut voir, les oreilles entendre, etc.). Cette capture informationnelle, réalisée par les différents récepteurs sensoriels, est conservée durant un laps de temps très court (généralement inférieur à la seconde). Cette information sensorielle passe alors en mémoire à court terme pour y être analysée, traitée et enfin éventuellement stockée en mémoire à long terme.
Il existe donc différentes mémoires sensorielles.
- La mémoire sensorielle visuelle (on emploie également par généralisation, à la suite des travaux de Neisser en 1967 le terme de mémoire iconique). C'est cette mémoire sensorielle visuelle qui nous permet par exemple de visualiser un film sans percevoir de pause dans le défilement des images, se fonde sur le phénomène de persistance visuelle (on parle d'image consécutive visuelle). L'intervalle de temps entre la présentation d'une image et de l'image suivante, inférieur à la durée de rétention en mémoire sensorielle visuelle, permet, par superposition, la transition d'une image à l'autre. Chaque image présentée très brièvement est stockée dans cette mémoire iconique.
Sperling (1960) a beaucoup travaillé sur ce type de mémoire et notamment sur la capacité des sujets à "rapporter" tout ou partie d'une stimulation visuelle. L'idée est de demander à des sujets de rapporter immédiatement après la présentation d'un ensemble de lettres ou de chiffres disposés d'une façon donnée (une matrice de 3X4), toutes celles dont ils se souviennent. Sperling projette aux sujets un arrangement visuel d'une durée variable en leur demandant de rapporter selon la procédure mise en place (partielle ou totale) soit une partie soit la totalité des lettres qui leur ont été présentées.
A)
|
Arrangement visuel |
|
Réponse demandée au sujet |
||||||
|
V |
R |
M |
N |
|
V |
R |
M |
N |
|
C |
W |
G |
J |
C |
W |
G |
J |
|
|
V |
B |
S |
A |
V |
B |
S |
A |
|
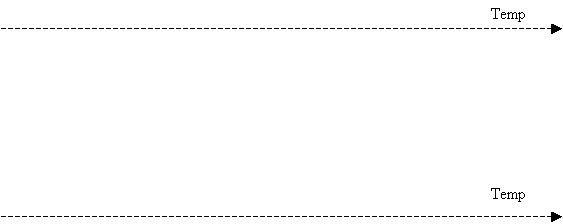
B)
|
Arrangement visuel |
Indicateur auditif |
Réponse demandée au sujet |
||||||
|
V |
R |
M |
N |
Aigu |
V |
R |
M |
N |
|
C |
W |
G |
J |
Médian |
C |
W |
G |
J |
|
V |
B |
S |
A |
Grave |
V |
B |
S |
A |
Protocole de Sperling (1960). A) : essai
dans une procédure de rapport complet. Présentation des stimuli pendant 50 ms
et réponse idéale du sujet. B) essai dans une procédure de rapport partiel.
Présentation des stimuli pendant 50 ms, présentation de l'indicateur auditif et
réponse idéale du sujet en fonction de la "hauteur" de ce stimulus. D'après
Fortin & Rousseau, 1989.
Ces travaux ont montré qu'en situation de rapport total, le sujet ne rapportait que 4 ou 5 éléments (sur 12 présentés, soit entre 33,3 et 46,7 %). Par contre, en rapport partiel, le sujet rapporte 3 éléments sur les 4 présentés (soit 75 % - ce pourcentage baisse en fonction de la durée entre la disparition de la présentation visuelle et l'émission du stimulus auditif, de 9 à 5 entre 0 et 1000 ms. Après 250 ms, le rapport partiel n'entraîne pas une meilleure performance que le rapport total). Ces travaux ont permis de mettre en évidence, lors d'une situation de rapport complet, les limites temporelles de la mémoire visuelle et sa détérioration rapide (comme si les éléments, à mesure qu'ils sont mémorisés, effaçaient les précédents).
- Il existe également une mémoire auditive dite échoïque (également depuis la proposition de ce terme par Neisser). D'autres auteurs, comme Darwin, Turvey et Crowder en 1972, ont étudié cette mémoire selon un protocole tout à fait semblable (et évidemment modifié) à celui utilisé par Sperling. Ces travaux ont montré une durée de la mémoire échoïque supérieure à celle de la mémoire iconique (on observe un délai de 4 secondes entre la disparition des stimuli auditifs et la présentation visuelle pour que la performance partielle baisse de façon significative par rapport à celle de rapport complet).
2) La mémoire à court terme
La mobilisation de l’attention est nécessaire pour passer d’une mémoire sensorielle à la mémoire à court-terme (celle-ci dépend en effet de l'attention portée aux éléments de la mémoire sensorielle). La mémoire à court terme sert à conserver une information pendant une durée brève, le temps nécessaire à la réalisation d'une tâche donnée (par exemple, le temps de composer un numéro de téléphone).
Serge Nicolas (2002) rapporte qu'en 1887, un maître d'école du nom de
Jacobs (Joseph) a cherché à mesurer la capacité intellectuelle de ses élèves.
C'est lui qui à l'origine de la technique dite de mesure de l'empan mnésique. Des
travaux plus récents dans ce domaine sont ceux de George A. Miller qui ont
montré que nous disposions d'une capacité limitée en mémoire à court terme. Le
titre de l'article publié en 1956 évoque le nombre magique de sept plus ou
moins deux. Cet auteur s'est intéressé au "montant" de l'information
que nous pouvions conserver en mémoire. Les expérimentations consistaient à présenter au sujet des listes de chiffres ou d'autres
éléments (ce pouvait être tout aussi bien des lettres, des mots, des
images, etc) de plus en plus longues et à lui
demander de les répéter dans l'ordre Cette information proposée est sans
dimension. Miller a utilisé dans ses travaux la notion de bit informationnel
pour quantifier ses données. Un bit est la quantité d'information nécessaire
pour prendre une décision entre deux alternatives égales ("Si nous devons
décider si un homme mesure plus ou moins de 6 pieds et si nous savons que les
probabilités sont de 50/50, alors nous avons besoin d'un bit
d'information" - quelle que soit l'unité de mesure utilisée). Un bit
correspond à la racine carrée du nombre d'éléments à retenir. Deux bits
d'information nous permettent de décider parmi 4 alternatives équiprobables, 3
parmi 8, 4 parmi 16, etc. "La règle générale est simple", dit Miller,
"chaque fois que le nombre d'alternatives augmente d'un facteur 2, un bit
d'information est ajouté". Evoquant dans son article les travaux d'auteurs
comme Pollack ou Garner (les résultats des sujets laissent apparaître une réponse
moyenne de 2,6 bits, avec un écart-type de 0,6 bit en fonction du type
d'élément considéré), Miller résume ces différents travaux en proposant qu'il
existe une "limite claire et définie à la précision avec laquelle nous
pouvons identifier de façon absolue l'amplitude d'une réponse à un stimulus
unidimensionnel." Il propose d'appeler cette limite l'empan de jugement absolu
(empan mnésique) et il "maintient que pour des jugements unidimensionnels,
cet empan se situe quelque part aux voisinage du chiffre 7±2, soit environ 2,652
bits. Cette tâche d'empan mnésique représente une
mesure courante de la capacité de la mémoire à court terme. La valeur de cet
empan varie en fonction de la nature des données (elle est plus élevée
pour un codage auditif que pour un codage visuel, pour la rétention de termes
familiers) et en fonction des individus. Ce n'est pas
seulement le nombre de chiffres, de lettres ou de mots qui constitue l'empan
mais le nombre de regroupements significatifs d'information. Miller a travaillé
également sur les chunks, peut se définir comme un groupement d'éléments ayant
une signification particulière. Il peut s'avérer plus difficile de retenir la
séquence GPD WMB (Fortin & Rousseau, 1989) que PDG BMW (surtout pour un
prof de gym heureux possesseur d'une vraie moto). De la même façon, l'effet de
similarité phonologique favorisera une meilleure rétention (BDC GTV vs
SKM VYF). L'élaboration de ces chunks procède selon Miller d'un recodage
permettant probablement d'augmenter la quantité de message que le sujet peut
retenir. Par exemple, l'utilisation des numéros verts qui procède par
regroupement , par rappel de blocs (0800 8OO etc..) permet d'en améliorer la
rétention. Il est probablement plus facile de retenir la liste de chiffres
0262526849 en créant des blocs comme 0262 526 849. Essayez vous-même.
La mémoire à court terme permet donc de garder en mémoire et de restituer et manipuler une nouvelle information pendant une durée limitée. La détérioration- on emploie le terme de déclin- survient dans un intervalle de temps allant de 15 à 30 secondes. A la différence de la mémoire sensorielle, elle peut être améliorée par un processus d'auto répétition. Le rôle de cette auto répétition consiste non seulement à maintenir l'information le temps que celle-ci soit utilisée, mais également à la traiter, ce qui justifie probablement l'emploi de l'expression mémoire de travail pour la mémoire à court terme. Un travail de traitement des données est réalisé à ce niveau. "La mémoire de travail permet d'effectuer des traitements cognitifs sur les éléments qui y sont temporairement stockés. Elle serait donc plus largement impliquée dans des processus faisant appel à un raisonnement, comme lire, écrire ou calculer par exemple. Une tâche typique qui la met à contribution consiste à restituer, dans l'ordre inverse, une série d'items qui vient d'être énoncée. Un autre bon exemple est la traduction simultanée d'un interprète qui doit faire la traduction tout en retenant les informations qui lui parviennent en même temps dans l'autre langue. La mémoire de travail serait constituée de plusieurs systèmes indépendants, ce qui impliquerait que nous ne sommes pas conscients de toute l'information qui y est stockée à un instant donné. Par exemple, lorsque nous conduisons une auto, nous effectuons plusieurs tâches complexes simultanément et il est peu probable que ces différents types d'information soient pris en charge par un système de mémoire à court terme unique."
Baddeley & Hitch (1974), Hitch & Baddeley (1976) ont proposé une mémoire de travail à plusieurs composantes. S'il existe une mémoire de travail, cela suppose "qu'existe un système susceptible à la fois de sélectionner, de maintenir et de traiter l'information pendant que le sujet effectue différentes tâches cognitives comme la compréhension, l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes, etc" (Weil-Barais, 1993). Selon ces auteurs, ce système n'est pas unitaire et se compose d'au moins trois sous-ensembles : un centre exécutif ou administrateur central jouant le rôle de système de contrôle, assisté de deux systèmes asservis, la boucle articulatoire et le registre visuo-spatial.

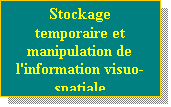
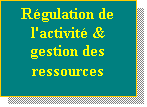
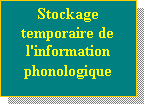
Le modèle de Baddeley (Baddeley, 1986, Baddeley
& Hitch, 1974, Hitch & Baddeley, 1976)
L'administrateur a un rôle essentiel. Selon Baddeley, ses caractéristiques sont semblables à celles d'un système attentionnel. Il possède essentiellement une fonction de régulation de l'activité (par exemple lors de la survenue d'une perturbation) et de gestion des ressources d'un système aux capacités limitées. Responsable de la sélection et de l'exécution des opérations de traitement, il nous permet de mener plusieurs opérations, de coordonner deux tâches en même temps (parler et conduire). Il est le lien, selon cet auteur, entre la mémoire de travail et la mémoire à long terme. La boucle phonologique comprend deux sous-systèmes. Le registre phonologique stocke temporairement l'information. Ce stockage est facilité par le second sous-système, l'auto répétition sub vocale qui permet un rafraîchissement constant, une réactivation dynamique de l'information, le transfert d'une image visuelle vers le code phonologique (les exemples les plus classiques sont la rétention d'un numéro de téléphone, d'une adresse, de la référence d'un ouvrage). Enfin, le système visuo-spatial encode et conserve les images visuelles et spatiales (par exemple se souvenir où nous avons garé la voiture). Il serait également responsable de la formation et de la manipulation des images mentales.
Comment jouer à tester notre mémoire de travail.
1) Empan verbal : l’empan de chiffres. On présente au sujet une série de 2 chiffres qu’il doit répéter dans l ’ordre. En cas de réussite, on présente une nouvelle série de chiffres de complexité supérieure. En cas d’échec, on présente une série de même niveau. (source : Todd Lubart) :
|
2 |
4 |
7 |
|
|
|
|
|
|
3 |
5 |
2 |
8 |
|
|
|
|
|
4 |
3 |
1 |
9 |
5 |
|
|
|
|
5 |
2 |
4 |
1 |
8 |
6 |
|
|
|
6 |
3 |
7 |
1 |
5 |
4 |
9 |
|
|
7 |
6 |
1 |
8 |
3 |
2 |
4 |
7 |
2) Empan spatial : l’épreuve des blocs de Corsi. Neuf cubes sont disposés aléatoirement sur une planche faisant face au sujet. L'expérimentateur touche un nombre prédéfini de cubes suivant une séquence particulière que le sujet doit reproduire (source : Todd Lubart) :
|
|
3) La mémoire à long terme
Nous avons vu précédemment que les informations traitées en mémoire à court terme étaient conservées durant un temps limité. Celle-ci comprend la mémoire des faits récents (quelques minutes par exemple), où les souvenirs sont encore fragiles. Elle se modifie sans cesse en raison des expériences nouvelles et des processus de restitution, de rappel à la conscience permettant l'approfondissement des traces mnésiques. Dans la mesure où le cerveau utilise des circuits différents pour la mémoire à long terme et la mémoire à court terme, cette mémoire à court terme n'est pas nécessairement le lieu de passage obligé pour l'élaboration de la mémoire à long terme. Des personnes souffrant de déficits de leur mémoire de travail ne perdent pas pour autant la possibilité de se construire de nouveau souvenirs. La mémoire à long terme est la mémoire des faits anciens, (plusieurs années) où les souvenirs ont été consolidés. Son fonctionnement est toujours objet de débats à l'heure actuel. Quoi qu'il en soit, celui-ci fait appel à des structures cérébrales particulières, se fonde sur de nombreux réseaux neuronaux et correspond à une modification physique durable des structures synaptiques. Ceci correspond à l'hypothèse proposée par le psychologue canadien Donald O. Hebb en 1949 de la persistance d'une activité électrique dans des groupes de neurones durant un certain temps, ceci entraînant des modifications cellulaires ou biochimiques durables renforçant la force de la liaison entre ces neurones (Laroche, 2001). Hebb émet la supposition selon laquelle l'activation simultanée de plusieurs neurones faciliterait la transmission d'informations entre ces neurones et leur permettrait de créer des circuits préférentiels. Les réseaux codent l’information par des modifications de l’efficacité de certaines de leurs connexions. Il énonce une hypothèse forte qui propose que l’activité électrique que l’on observe dans ces circuits de neurones lors d’un apprentissage persiste pendant un certain temps, comme pour frayer un chemin, et que cela entraîne des modifications cellulaires ou biochimiques des neurones activés, de sorte que la force synaptique entre eux augmente. Ceci expliquerait la création de souvenirs dans le cerveau, souvenirs pouvant ainsi se maintenir pendant des années par le jeu des expériences sensorielles qui laissent des traces dans le cerveau en modifiant tout à la fois l’efficacité des liaisons synaptiques entre neurones et la structure des réseaux neuronaux. Nous y reviendrons.
La mémorisation des souvenirs s’accompagne donc d’une modification des synapses. Leur activation fait resurgir les souvenirs qui y sont imprimés. Ces schémas se réorganisent constamment en fonction des affects, du contexte On comprend mieux ainsi pourquoi la mémoire n’est pas une copie nécessairement conforme de la réalité : lorsque nous évoquons le visage d'un proche, il est probable que l’image qui nous vient à l’esprit n’a jamais existé. Elle est une reconstruction à partir de réminiscences du passé et d’impressions du moment présent.
3.1. Trois processus
Certaines
informations "appartenant" à la mémoire à court terme seront
consolidées, renforcées, et passeront en mémoire à long terme. La construction
de ces différentes mémoires et les échanges permanents qui caractérisent leur
fonctionnement sont donc rendus possibles grâce à trois processus fondamentaux :
l'encodage, la consolidation et la restitution ou la récupération.
a) Encodage
C'est un processus de sélection des différentes informations (auditive, tactiles, visuelles, gustatives, etc.) grâce auquel ces informations vont être enregistrées, placées en mémoire à long terme. L'information ou l'événement vont donc être transformés en trace mnésique au terme d'un processus actif. Grâce au codage, une trace va être élaborée qui non seulement donne du sens à cette information, mais permettra par la suite de retrouver celle-ci, de la restituer (comme si ce codage permettait de délivrer un certain nombre d'indices, favorisant à un moment donné l'association d'idées ou de caractéristiques d'un objet). Comme nous l'avons déjà précisé précédemment, le contexte environnemental, l'aspect émotionnel jouent un rôle important dans l'élaboration de ces indices. Plus ce codage est fort (plus il sollicite de zones du cerveau par exemple), de qualité, meilleures seront à la fois l'organisation des informations à retenir, les représentations mentales de ces informations et leur restitution. Il semble de ce point de vue d'ailleurs que ce soit la qualité du codage, davantage que la quantité de traitements à effectuer, qui soit déterminante dans la capacité des sujets à retenir les différentes informations.
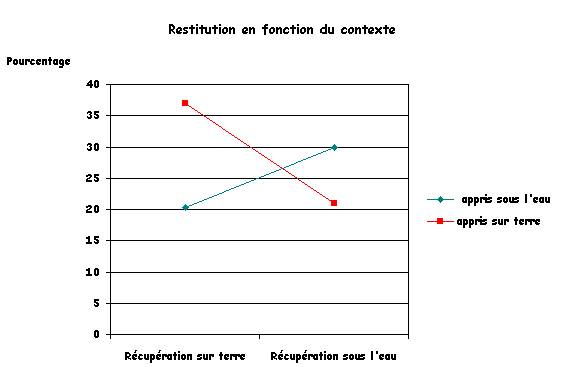
Importance du contexte dans la récupération des informations (d'après Godden et Baddeley, 1975)
Diverses expériences classiques montrent l'importance du contexte et de l'aspect émotionnel dans l'encodage et la restitution. L'une d'entre elles a été réalisée par Godden et Baddeley en 1975. L'expérimentation comprenait deux populations de plongeurs sous-marins. Pour la moitié des sujets, l'apprentissage s'est déroulé sous l'eau et pour l'autre moitié sur la plage. Ces chercheurs ont demandé à des sujets d'apprendre un certain nombre de chiffres. La qualité de la restitution a été testée à la fois sous l'eau et sur la plage pour les deux populations. Les résultats montrent (voir courbes ci-dessus) que la restitution dans le même contexte que celui de l'apprentissage entraîne de bien meilleures réponses.
Les sujets apprenaient une liste de mots soit sur la plage, soit sous l’eau et devaient ensuite rappeler cette liste soit dans le même environnement soit en changeant d’environnement. Lorsque les sujets avaient appris la liste dans un environnement donné et devaient effectuer le rappel dans un autre, les performances mnésiques chutaient de 40% par rapport aux cas où l’encodage et la restitution avaient lieu dans le même environnement. Les mots appris au fond de la piscine sont 1 fois et ½ mieux rappelés lorsque le sujet se retrouve dans le même environnement pour le rappel que lorsqu’on lui demande se souvenir des mots sur terre. On peut en conclure que le contexte est porteur d’indices qui aident d’autant plus le sujet à se souvenir que les conditions du rappel sont proches des conditions d’apprentissage.
b) Consolidation
Consolider, c'est lutter contre l'oubli. C'est un processus dynamique qui met en jeu la répétition, la fréquence de la présentation de certaines informations (les révisions par exemple), l'association de différentes informations (relier un événement à d'autres événements, à un lieu particulier). La phase paradoxale du sommeil joue également un rôle déterminant dans cette étape de consolidation de la trace mnésique. Chacun se construit ainsi un système d'aide-mémoire lui permettant d'utiliser de façon efficace à la fois l'encodage et la récupération. Il se peut cependant que se produisent des interférences (variables selon les sujets) entre l'apprentissage antérieur et un nouvel apprentissage, comme s'ils entraient en compétition l'un par rapport à l'autre. Une illustration typique dans ce domaine est l'apprentissage d'une nouvelle langue (exemple personnel cité par Baddeley de la confusion entre italien et espagnol à propos du mot merci, confusion et/ou oubli du à la similarité du nouveau mot avec l'ancien, ou bien de la force de l'association entre une initiale et un terme : c = cold dans la langue maternelle et caldo ou chaud en italien). On parle d'interférence rétroactive lorsque les informations récentes prennent progressivement la place d'informations plus anciennes, comme si l'oubli augmentait à mesure du nouvel apprentissage et d'interférence proactive lorsque la force des souvenirs anciens prend le pas sur les nouveaux apprentissages.
c) Restitution, récupération
Cette dernière phase va faire appel encore une fois à des mécanismes actifs utilisant les différents moyens mis en œuvre par le sujet notamment au cours de la phase d'encodage (indices, caractéristiques, différences, particularités) pour constituer des traces mnésiques. De la qualité des différents indices dépendra la facilité avec laquelle un événement sera récupéré, remémoré. Il faut savoir par ailleurs que ce n'est pas parce qu'un souvenir ne sera pas remémoré qu'il aura été oublié. Il peut demeurer en mémoire à long terme, mais ne pas être restitué du fait d'un processus de restitution non efficace.
La récupération peut être soit rapide et automatique avec un sentiment de familiarité, ou bien alors contrôlée, ce qui implique l'accès à l'information contextuelle d'origine.
Ces trois phases ont donc permis l'élaboration de la mémoire à long terme. Selon différents auteurs (e.g. Tulving, 1983), celle-ci est organisée en différents sous-systèmes en constante interaction (cf. infra). Elle peut être divisée en mémoire déclarative ou explicite (qui repose sur le souvenir de connaissances qui sont de l'ordre du savoir) et en mémoire non déclarative ou implicite ou procédurale (qui repose sur des habiletés qui sont de l'ordre du savoir-faire, de l'exécution). Eustache et Faure (2000, p. 149) nous rappellent que les concepts de mémoire déclarative et de mémoire procédurale ont d'abord été utilisés dans le domaine de l'intelligence artificielle avant d'être proposés par Cohen et Squire en neuropsychologie. La façon la plus simple d'opérer une distinction entre mémoire implicite et mémoire explicite est d'associer l'explicite à la mise en œuvre de stratégies conscientes de recherche de l'événement ou de l'information et l'implicite à l'absence de mise en œuvre de ce type de stratégies.
3.2 Mémoire procédurale ou implicite
Encore mal comprise, la mémoire procédurale est une mémoire inconsciente, difficilement verbalisable. Elle s'exprime dans l'activité du sujet et peut s'objectiver sous la forme d'actions, d'habitudes ou d'habiletés motrices (perceptivomotrices, pereptivo-verbales, sensorimotrices), cognitives (comme la résolution du problème de la tour de Hanoï) ou d'automatismes (conduire une automobile, se déplacer à vélo, etc.). Elle se manifeste chaque fois qu'une expérience antérieure, unique ou répétée, facilite la performance dans une tâche sans pour autant qu'il soit nécessaire de faire appel au souvenir de cette expérience (Laroche et Deweer, 1994). Comme le précise Combe Pangaud (2000), cela "suppose l'acquisition graduelle et le maintien d'aptitudes à agir sur le monde suivant des programmes, surtout moteurs, et des procédures." L'apprentissage est généralement assimilé à la mémoire implicite et cette mémoire est habituellement fiable.
Pour ce qui concerne la mémoire implicite, Nicolas (2002) rappelle qu'une des tâches implicites les plus anciennes et les plus connues consiste à demander aux sujets de compléter (tâche de complétion) un trigramme (un radical de trois lettres) qui leur est présenté. Par exemple, si l'on présente le radical cra, le sujet peut compléter par vate, tère, paud, etc. On constate que lorsque ces radicaux ont été proposés à des amnésiques ou à des sujets ne souffrant d'aucun trouble mnésique lors d'un test initial, la probabilité de leur complétion ultérieure par des mots préalablement étudiés est plus élevée lors d'une nouvelle évocation alors même que de nouveaux ou d'autres mots sont possibles. Cet effet est appelé effet d'amorçage direct (priming), il "représente l'influence automatique, parfois même inconsciente, de la mémoire dans une tâche donnée" (Nicolas, 2002). "Il possède pour fonction d'améliorer la perception de stimulus récemment rencontrés, sans que nous ayons nécessairement conscience de l'amélioration de la vitesse ou de l'efficacité de la perception"(Squire & Kandel, Pour la Science, 2001).