Conduite motrice
Télécharger CM Conduite motrice(Sur ce lien, clic droit puis enregister la cible sous...)
I. La motricité humaine, entre fait biologique et fait social.
La
motricité est-elle naturelle ?
Il existe à la fois des aspects biologiques (régies génétiquement), et des aspects sociaux (tenir compte de l’environnement).
" C’est un mystère que l’homme marche sur ses pattes arrières. Cela entraîne des complications ( sciatique, hémorroïdes…). Il est mieux pour nous de marcher à 4 pattes. "
La marche n’est donc pas naturelle, pour l’homme.
Un bébé à la naissance a des réflexes locomoteurs, mais ne sait pas marcher. C’est le milieu humain qui va donner de la valeur à la marche. Si tout le monde rampait, le bébé ne marcherait pas. Si un acte moteur n’est pas valorisé, il ne sert à rien. Cependant le bébé est équipé biologiquement pour marcher.
Les enfants sauvages.
Privés dans la petite enfance d’un entourage humain, qui ont grandi " naturellement ", n’ont pas eu de modèles sociaux à certains stades de l’apprentissage.
Les enfants placards.
De nos jours, dans nos sociétés, on a des cas d’enfants placards. Ils sont barricadés par les " responsables ". Sans contacts humains, sans modèles, ils ont des carences motrices.
La motricité se construit donc par des
modèles.
Les techniques
du corps.
" J’entends par ce mot ( technique ) les façons dont les hommes, sociétés par sociétés, d’une façon traditionnelle savent se servir de leur corps ".
D’un continent à l’autre, d’un pays à l’autre, nous avons un point de vue différent des autres. De même la motricité humaine diffère selon les sociétés. Il y a bien sûr un problème historique.
On peut donc ressentir une différence de motricité dans les sports entre toutes les nations. Il existe donc une culture du sport propre à chaque nation.
" Les différentes gymnastiques
sont des grandes constructions à la fois sociales et physiques ".
Lévi-Strauss
Il n’y a que l’espèce humaine qui a construit des gymnastiques.
II. Un modèle d’analyse : le langage
|
Son |
Voix |
Parole |
Langue |
Langage |
linguistique |
|
Mouvement |
Motricité |
Conduite motrice |
Jeu sportif |
Action motrice |
Praxéologie |
Si on ne peut pas produire de son avec la bouche, on ne parle pas.
La voix est le fait que les sons vont être produits d’une certaine façon grâce à l’appareil phonatoire.
La parole : des sons traduits par la voix mais articulés d’une manière qui respecte un code.
La langue : correspond à un code donné, utilisé par la parole. Respecte une combinatoire .
Le langage : uniquement chez l’homme, car il est physiologiquement apte.
Le mouvement : la modification des angles d’une ou plusieurs articulations, ou de la position générale du corps.
La motricité est la combinaison de plusieurs mouvements provoqués volontairement (en général ).
Conduite motrice : usage de la motricité dans un contexte précis avec une intention précise. Cela dépend donc d’un contexte. C’est le comportement moteur (aspects externes ) en tant que porteur de significations ( aspects internes ).
Langage
|
Action motrice
|
|
Approche physique : vibration, timbre, fréquence, intensité |
Approche physique : résistance, frottement, vitesse, amplitude, fréquence |
|
Approche biomécanique : position de la bouche, de la langue, rôle du diaphragme, des intercostaux, des abdominaux |
Approche biomécanique : contraction, relâchement, rotation, fermeture, ouverture, segments, leviers |
|
Approche physiologique : fonction respiratoire et ventilatoire |
Approche physiologique : système cardio-vasculaire, ventilatoire, fonction cellulaire, effort, récupération, conditions spécifiques |
|
Approche neuro-physiologique : commande motrice, type d'ordre cérébral, câblage des circuits |
Approche neuro-physiologique : connexions et synergies musculaires, sollicitations nerveuses, programmes moteurs sollicités, type de "mémoire" motrice, réajustements |
|
Approche psychologique : choix des mots, tournure des phrases, intentions, tonalité, débit |
Approche psychologique : traits de personnalité, motivation, représentation de la situation, choix du type de conduite, compréhension générale |
|
Approche psychanalytique : blocage, raté, lapsus, bégaiements, troubles |
Approche psychanalytique : blocage, "pertes de figures", actes manqués, stress |
|
Approche sociologique : niveau de langage, style, formes particulières ou dérivées, idiomes |
Approche sociologique : type d'activité physique, logique de choix, distinction sociale à l'œuvre |
|
Linguistique : lexique, syntaxe, loi de composition interne, types d'énoncés |
Action motrice : fonction interne, présence ou absence de partenaire ou d'adversaires, nature de l'environnement physique, enchaînement possible des actions motrices, système de contraintes à respecter, type de marque, comptabilité des points |
|
Secteurs d'intervention : - éducation : apprendre à parler - rééducation, adaptation : aphasie, phoniatrie - performance : diction, chant, animation |
-éducation : éducation physique, initiation sportive (éducation et motricité) - rééducation, adaptation : kinésithérapie, APA 3e âge - performance : entraînement sportif (performance et entraînement sportif) |
III. Problématique de l'action motrice
L'action motrice
Définition : c'est le processus d'accomplissement des conduites motrices d'un ou de plusieurs sujets agissant dans une situation motrice déterminée. Cette action motrice a 4 caractéristiques :
- L'action motrice est constitutive de la tâche à réaliser
- Cette action motrice est déterminée par les lois biologiques et physiques qui gouvernent la matière
- L'action motrice se déroule en motricité réelle et non virtuelle
- L'action motrice est toujours porteuse de sens
Ces 4 caractéristiques sont indissociables.
|
Langue
/ jeu sportif |
Parole
/ conduite motrice |
|
Un code. Une mise en correspondance d'actions, de significations selon un cadre réglementaire |
Utilisation. Mise en œuvre de ce code par les sujets agissants. |
|
Passivité. La possession du code met en jeu les seules facultés réceptrices de l'esprit; mémoire, compréhension. |
Activité. Habileté technique, combinaison et organisation de ces habiletés, saisie générale du sens du jeu. |
|
Un phénomène social |
Un acte individuel |
Le jeu sportif.
C'est la langue des sportifs. C'est une situation précise avec des caractéristiques très fortes. C'est un système de contraintes que tout joueur doit respecter.
La théorie des jeux.
On appellera une situation de jeu toute situation où un joueur :
- Doit faire des choix
- Doit faire des choix parmi un certain nombre possible
- Des choix dans un cadre défini à l'avance
- Où ces actions doivent déboucher sur une issue et ce résultat doit être associé à un gain (positif ou négatif).
On appellera jeu sportif toute situation motrice, d'affrontement (enjeu compétitif), codifiées. On s'oppose soit à la matière physique soit à autrui, mais toujours dans un affrontement direct.
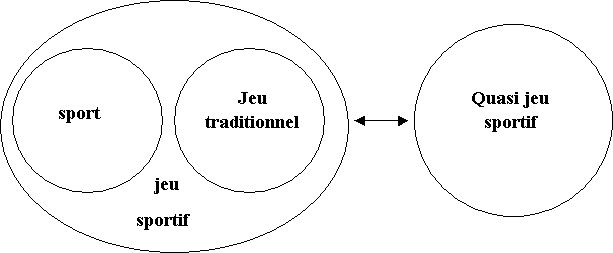
Le sport est un sous ensemble du jeu sportif et est hétéro codifié. Le sport est codifié par une institution. Le sport, c'est l'ensemble fini et dénombrable des situations motrices codifiées sous forme de compétition mais surtout institutionnalisées (par les fédérations).
Le jeu de tradition est auto codifié.
|
|
Situation motrice |
Codification compétitive |
Fédération |
|
Échecs |
- |
+ |
+ |
|
Quasi jeu |
+ |
- |
- |
|
Jeu sportif |
+ |
+ |
- |
|
Sport |
+ |
+ |
+ |
Le quasi jeu a des contraintes qu'on est pas obligé de respecter. Il n'y a pas de règles strictes.
Sous une même étiquette (surf, basket) il peut y avoir de larges différences. Les systèmes sont différents, les règles aussi.
Un quasi jeu passe au sport par la sportivisation. Le processus inverse peut s'avérer réel. Le fait d'être classé sport ne dépend pas de la dépense énergétique (tir au pistolet).
Le contrat ludo-sportif.
Le sport ou les jeux reposent sur un système de contraintes et de contrats très marqués. C'est une entente préalable, se mettre d'accord sur l'essentiel : terrain, gain, matériel… Chaque joueur est sensé connaître les règles du jeu. Ce contrat a 3 caractéristiques :
- Il est librement accepté
- Il est provisoire et délimité
- Il est intermittent
Il renvoie à 2 aspects :
- Descriptif : il décrit les conditions de jeu
- Prescriptif : dans un cadre, il est permis et interdit un certain nombre de choses. Tenir compte également du "non-dit".
Dans le descriptif, il existe 5 éléments dont on doit tenir compte :
- l'espace de pratique : tous les sports délimitent une surface. Cet espace doit être respecté.
- Le temps : la durée
-
Le matériel
-
Les participants
-
L'objectif
Dans le prescriptif, il y a des obligations, des interdictions, les non-dits ou zones d'ombre où rien n'est dit sur certaines choses. La pratique peut évoluer grâce à ces zones d'ombre.
Il y a néanmoins des codes prescriptifs stricts où l'on ne peut faire autre chose.
Certains codes laissent une plus grande marge de liberté, et d'autres qui laissent une marge de liberté quasi illimitée.
On peut analyser l'évolution d'un sport par l'étude du règlement.
Les non-dits.
(exemple : le javelot)
On pouvait, jadis, lancer le javelot comme on le voulait. Dans les années 50, on tournait sur soi-même pour le lancer. Cela marque une évolution. Puis la fédération refuse ce type de lancé car elle le juge trop dangereux. Elle ajoute donc des points au règlement.
Une fédération peut accepter ou refuser une innovation pour l'évolution d'un sport.
Une fédération peut imposer un nouveau point pour faire évoluer le sport. Le changement de règles par une fédération est fait pour le spectacle avant tout.
Les grandes
catégories de situations motrices.
Il existe des problèmes de classification.
On va regrouper des situations motrices en un certain nombre de familles.
Il faut respecter un certain nombre de critères.
- la pertinence ou le point de but
- des classes d'équivalence distinguables
- les familles sont disjointes
- les familles sont exhaustives
- une bonne classification doit être accueillante
Pour toutes les activités, différents critères les définissent :
Le substrat : activité sur terre, l'eau, l'air…
Sport collectif, sport individuel
Les activités que l'on ne peut classer directement (tennis, pétanque…)
En STAPS, on utilise une classification selon le point de vue scientifique. Un économiste classerait différemment. Nous nous attacherons à classer selon l'action motrice.
Sport de combat : préhension, percussion
Sport gymnique : gymnastique, tumbling, trampoline…
Sport individuel : athlétisme, natation, tir à l'arc…
Sport collectif : handball, volley-ball, water-polo…
Sport de pleine nature : escalade, canoë, voile…
Sport mécanique : motocyclisme, motonautisme, bobsleigh…
On a multiplié les critères, ce qui est un obstacle à une bonne classification. Or, nous voyons ici que certains critères se chevauchent. D'autre part, des activités ne sont pas classées (sport équestre, tennis…)
Activités athlétiques : athlétisme
Activités aquatiques : natation, natation synchronisée
Activités gymniques : gymnastique, GR, trampoline
Activités artistiques : danse, cirque
Activités de pleine nature : voile, canoë, escalade
Activités de coopération et d'opposition : sports collectifs
Activités de combat : lutte, boxe, judo
Activités d'opposition duelle : sports de raquette
Cette classification est plus riche. Mais elle n'est pas unifiée au niveau des critères. La première classe est un sport. D'autre part, le critère change, on passe du substrat au type. Puis on a le critère matériel (raquette), dans ce cas il manquerait le ballon ou la balle. On a des chevauchements des activités. L'aquatique peut se retrouver en APN.
Ces classifications ressortent de l'habitude. Elles n'ont pas été faites selon une logique, mais selon un empilement.
Un auteur a trouvé un critère de classification : Pierre Parlebas.
Il a classé les activités physiques selon l'action motrice (modèle scientifique). Il part d'un critère : le critère d'interaction motrice. Il faut considérer une activité comme un système ou un microcosme. Au centre de ce système, c'est l'individu. Puis les relations avec l'environnement et le milieu (aspects physique et humain). Ce sont 3 éléments indissociables. Ils sont en interaction. Cela forme donc le système. Si l'on modifie l'un des éléments, on modifie le système.
Puis viennent les embranchements :
L'environnement (physique) : où pratiquer l'activité ? On va distinguer 2 extrêmes :
- l'environnement certain : l'environnement ne change pas, ne se modifie pas, il est prévisible.
- L'environnement incertain : il va se modifier en cours de pratique.
Entre les 2, on va instaurer un notion d'échelle, ou de continuum.
L'incertitude totale, c'est lorsqu'on est en milieu sauvage.
Le milieu aménagé est muni de repères, il est balisé.
L'espace domestiqué, façonné ou modelé par l'homme. Le principe est de diminuer les fluctuations.
Le milieu artificiel, l'environnement naturel n'existe plus. L'artifice, c'est substituer à la nature.
L'environnement peut être urbanisé, cela détourne l'espace originel de son utilisation première.
Le milieu (humain) : on va agir seul ou avec autrui. Quand on agit seul, on appelle cela une situation psychomotrice. C'est un jeu au cours duquel le pratiquant agit en isolé sans entretenir d'interaction motrice opératoire avec un autre pratiquant.
Quand on rencontre autrui, ce peut être un partenaire P, un adversaire A; ce sont des activités socio-motrices. La socio-motricité, c'est une situation dans laquelle les interactions motrices avec autrui sont obligatoires et constitutives de la tâche.
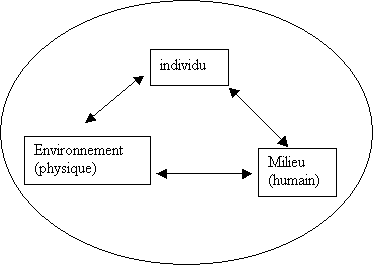
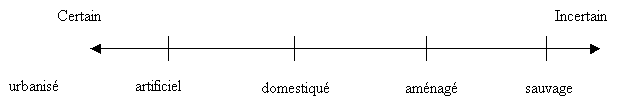
![]() Ø
" Ø
Ø
" Ø
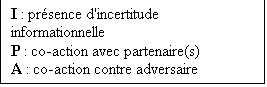
![]() P
" P
P
" P
![]() A
" A
A
" A
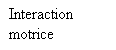 P,
A " P,A
P,
A " P,A
![]()
![]() Ø
" I
Ø
" I
![]() P
" I, P
P
" I, P
P,
A " I, P, A

De nombreuses activités sont de co-motricité, il n'y a pas d'interactions motrices directes mais une adaptation en fonction des mouvements d'autrui. Au tennis la socio-motricité positive, c'est quand on fait des échanges de balle avec un partenaire. C'est une coopération.
Dans la catégorie de socio-motricité de coopération, on dira que les interactions entre partenaires sont des communications motrices.
La co-motricité est présente dans les jeux où l'espace de pratique est partagé avec d'autres et cette proximité va entraîner des interactions qui ne sont pas obligatoires, les interactions sont potentielles
Cette classification ne regroupe pas des sports ou des jeux, ils ne viennent qu'illustrer ces critères.
IV. Aspects de l'interaction motrice
V. Conduite motrice et prise de décision
VI. La logique interne des jeux sportifs
Dans le jeu sportif, il y a le "je". L'individu peut créer des situations motrices. Cette créativité permet l'évolution d'un sport ou d'un jeu sportif.
Catégorie I, P, A
Évolution et progression
Une information complète, c'est lorsque tous les joueurs connaissent tous leurs choix, ceux des adversaires et ceux des jeux.
Une information parfaite, dans un jeu où les joueurs jouent à tour de rôle en ayant connaissance des choix précédents des autres joueurs. En revanche dans une même discipline, on peut être tantôt en information imparfaite, puis en information parfaite. En gymnastique ou en patinage artistique, le premier qui passe ne sait pas ce que fait celui qui passe en dernier ou après lui.
Catégorie I
La logique des jeux est d'être confronté à l'imprévu. En revanche les Activités Physiques de Pleine Nature ne rentrent pas dans cette catégorie.
|
|
I |
I |
|
Nature + |
Escalade Trial |
Aviron golf |
|
Nature - |
Escalade sur mur trial |
|
|
|
I |
I |
|
Stabilité |
Escalade |
|
|
Instabilité |
Surf |
Anneaux (en gymnastique) |
On dit qu'un milieu est incertain quand on ne sait pas ce qui va arriver (imprévisible). Il existe des degrés d'imprévisibilité.
Catégorie P, A
Fait appel à la socio-motricité.
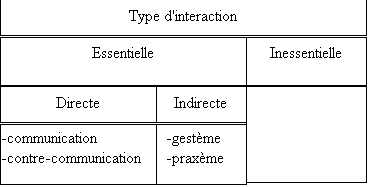
Les praxèmes sont des classes d'action. Le geste prépare une action.
Une interaction motrice inessentielle, n'est pas constitutive de la tâche.
L'interaction motrice essentielle participe de façon constitutive à l'accomplissement de la tâche.
Lorsqu'elle est directe, elle est imposée par le règlement.
Lorsqu'elle est indirecte, elle ne constitue pas obligatoirement le jeu, mais elle permet la réalisation dans les meilleures conditions des interactions motrices directes.
Le gestème est une classe de gestes ou de mimiques surajoutés à la réalisation de la tâche. Les gestes se substituent à la parole.
Le praxème est la classe des actions qui a une signification tactique
En classe P
2 types d'interaction. Situations où les interactions sont directes. On voit cela dans le cirque et l'acrosport, et dans certaines pratiques de danse.
Il existe très peu de pratiques avec interactions indirectes (du moins dans cette classe).
La mise en jeu de la conduite motrice
- Les différents partenaires se connaissent. Des automatismes se mettent en place. Il y a donc de la pro action (anticipation) dans le mouvement.
- Dans certaines situations motrices, on ne connaît pas forcément le partenaire avec lequel on va interagir. On va donc dans l'improvisation à partir d'un code commun (canevas). Les conduites sont d'abord réactives avec une difficulté de compréhension. Au fur et à mesure, une habitude s'installe pour pouvoir pro agir (anticiper) et même pré agir (imposer).
En classe A
3 cas de figure
- Les interactions motrices sont indirectes. Comme dans les courses longues, on partage le même chemin.
- Les duels d'individus. En combat, la cible est le corps de l'adversaire. Il y a simultanéité des gestes. La dominante est l'interaction motrice directe. Ce ne sont que des contre-communications.
- Les sports de raquette. Le jeu est discret, discontinu, car les actions ne sont pas simultanées.
En classe P, A
En pratique de double, il y a 2 types d'interactions motrices : directes ou indirectes.
En direct avec l'adversaire. En indirect avec son partenaire.
En sport collectif, ce sont des communications (à l'intérieur d'une équipe) et des contre-communications (entre les équipes).
Le 3e cas concerne les régates en équipage. Dans l'équipage, ce sont des communications directes et indirectes. Entre les 2 bateaux ce sont des contre-communication.
Tout jeu sportif obéit à des règles. Ces dernières donnent des droits et des devoirs. Cela débouche sur un rôle moteur. Tout joueur a donc un statut. Dans le jeu sportif, le statut est un rôle.
Le rôle, c'est une classe de comportement moteur associé à un statut particulier. A un statut correspond un rôle. Et tout rôle est associé à un seul statut.
|
|
Serveur |
Relanceur |
Échangeur |
|
Interaction motrice |
|
|
|
|
Rapports à l'espace |
|
|
|
|
Rapports à la balle |
|
|
|
Le serveur ouvre le jeu, la balle ne vient pas de l'adversaire. Il est derrière la ligne, à droite ou à gauche. Il sert dans un espace. Il se lance la balle à lui-même. Le relanceur est placé où il veut, mais laisse la 1re balle rebondir. L'échangeur fait ce qu'il veut.
On ne doit pas confondre rôle et
fonction.
Au rugby, Arrière et Ailier sont des fonctions. Tous les joueurs de rugby peuvent faire la même chose. Les fonctions concerne donc la stratégie. Le rôle concerne un cas juridique (règlement).