CM 2 : Le muscle squelettique
2-5 : COMPARAISON AVEC LES AUTRES TYPES DE MUSCLES :
2-5-1 : Cellules
musculaires cardiaques :
Pas de grande différence entre le muscle cardiaque et le muscle squelettique. Ces cellules sont composées de cellules cylindrées et striées. Le muscle est également strié. La cellule cardiaque ne possède pas qu’un seul noyau situé au centre de la cellule. Elle est plus petite (100μm pour 3cm à la cellule squelettique). Les cellules cardiaques sont reliées les unes aux autres par leurs extrémités, à l’aide d’un épaississement du sarcolème, appelé disque intercalaire. Les filaments d’actine s’insèrent dans le disque intercalaire. Les myofibrilles des cellules cardiaques forment un ensemble continu. Les cellules cardiaques sont reliées entre elles pour former deux réseaux (les oreillettes et les ventricules). Elles sont connectées entre elles par des jonctions communicantes, lacunaires. Cela permet la propagation du potentiel d’action (passage du potentiel d’action d’une cellule à une autre). Le réticulum sarcoplasmique existe dans les cellules musculaires cardiaques, mais est beaucoup moins développé que celui des cellules musculaires squelettiques. En effet la dépolarisation de la première se fait par le calcium extracellulaire contrairement à la cellule musculaire squelettique, dont le calcium provient du réticulum sarcoplasmique). La cellule musculaire cardiaque contient plus de mitochondries et de réserves lipidiques (le métabolisme cellulaire est préférablement oxydatif).
2-5-2 : Cellule
musculaire lisse :
La cellule
musculaire lisse n’est pas striée. Sa forme est une sorte de fuseau. Elle est
beaucoup plus petite que la cellule musculaire squelettique. Elle possède un
noyau central. Les filaments d’actine et de myosine ont une disposition
aléatoire (pas de stries). Il n’y a pas de sarcomère. Il existe des filaments
intermédiaires de support, qui se lient à des structures, les corpuscules
denses. Ces dernières se trouvent au niveau du sarcolème ou du cytoplasme. Les
filaments d’actine-myosine ont une orientation oblique par rapport à l’axe
cellulaire. Ils sont encrés au niveau des corpuscules denses, à la membrane
plasmique. L’intérêt majeur est qu’elle peut subir des étirements très
importants, tout en conservant des capacités de contraction. Elle entre dans la
composition de la paroi des vaisseaux.
III - CONTRACTION DU MUSCLE SQUELETTIQUE :
3-1 : INNERVATION MOTRICE DU MUSCLE SQUELETTIQUE :
Une cellule musculaire squelettique est innervée par un neurone moteur ou motoneurone du système nerveux somatique volontaire. Une cellule musculaire est innervée par une fibre nerveuse. La jonction entre le nerf et la cellule musculaire s’appelle plaque motrice. Un motoneurone est capable d’innerver plusieurs cellules musculaires ; il s’agit d’une unité motrice.
3-1-1 : Plaque
motrice :
L’axone et ses collatérales vont se terminer en des terminaisons axonales. Leurs extrémités se dilatent et forment un bouton synaptique (contact entre le nerf et la cellule musculaire). C’est le lieu de la transmission de l’influx nerveux. Une fibre musculaire ne présente qu’une plaque motrice, située au milieu de la fibre généralement. La plaque motrice est constituée de trois éléments :
![]() VR r
c Ramification du motoneurone
Vésicules
synaptiques
VR r
c Ramification du motoneurone
Vésicules
synaptiques
![]()
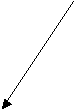
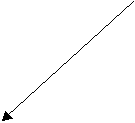 contenant de
contenant de
![]()
![]() Terminaison axonale du
motoneurone l’acétylcholine
Terminaison axonale du
motoneurone l’acétylcholine


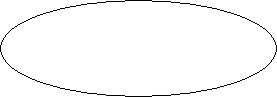
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() Espace synaptique
Espace synaptique
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sarcolemme de la fibre
Récepteur de l’acétylcholine sur la
musculaire membrane de la fibre musculaire
· L’élément pré synaptique : nerveux. La membrane de la terminaison axonale est appelée membrane pré-synaptique. Cet élément est très riche en mitochondries. Il contient des vésicules synaptiques qui contiennent le neurotransmetteur, l’acetylcholine (4000 molécules d’acétylcholine par vésicule). Le neurotransmetteur est synthétisé au niveau des terminaisons neuronales à partir de la choline et l’acétate. De nombreux canaux calciques, voltages dépendant se trouvent au niveau des membranes
· L’espace synaptique (60μm) : il sépare l’élément nerveux de l’élément musculaire.
· L’élément post-synaptique : musculaire. Il comprend le sarcolème (cellule musculaire) qui présente de nombreuses invaginations, qui augmentent la surface de contact. Au niveau de la membrane, il y a des récepteurs spécifiques (protéines) à l’acétylcholine incorporés (30 à 40 millions de récepteurs au niveau de la plaque motrice).Les récepteurs cholinergiques.
3-1-2 : Unités
motrices :
Une fibre musculaire est innervée par un seul motoneurone. Le motoneurone peut innerver plusieurs fibres musculaires grâce aux ramifications de l’axone et des collatérales. L’unité motrice correspond au motoneurone et à toutes les fibres innervées. En moyenne, le motoneurone innerve 150 fibres musculaires (5, dans le muscle oculaire externe, à 2000, dans les gros muscles comme le tibial antérieur). Le nombre de fibres musculaires, dans les unités motrices, varie en fonction de la taille du muscle et selon la finesse du mouvement. Les muscles impliqués dans un mouvement précis (muscle oculaire externe) auront très peu de fibres musculaires par unité motrice. Les muscles impliqués, dans les mouvements moins précis et plus puissants, auront un grand nombre de fibres musculaires par unité motrice. Toutes les fibres musculaires d’une unité motrice sont du même type. Elles ont les même caractéristiques structurales et métaboliques. Toutes les fibres se contractent et relachent ensemble (loi du tout ou rien). Les fibres musculaires d’une même unité motrice peuvent être dispersées dans le muscle.
3-2 : EXITATION :
La première phase de contraction a lieu au niveau de la plaque motrice. Lorsque le motoneurone est excité, le potentiel d’action parcourt l’axone et arrive au niveau de la terminaison axonale. Cela induit une entrée de calcium au niveau de la membrane (ouverture de canaux). Les molécules d’acétylcholine sont libérées suite à l’exocytose des vésicules. Les molécules se trouvent dans l’espace synaptique. Elles se fixent sur les récepteurs cholinergiques de la membrane musculaire. Cette fixation ouvre un canal qui permet l’entrée de sodium. Cette entrée induit une dépolarisation locale, appelée potentiel d’action de plaque motrice. Il se transforme en potentiel d’action musculaire et se propage des 2 côtés de la plaque motrice. Plus le nombre de vésicules exocytées augmente, plus le nombre d’acétylcholine fixée augmente, le potentiel d’action de la plaque motrice progresse jusqu’à provoquer la contraction musculaire.
Les molécules d’acétylcholine non fixées ont une durée de vie très brève (quelques milli-secondes). L’acétylcholine est dégradée dans l’espace synaptique par l’acétylcholine-cholestérase, ce qui permet la repolarisation et évite la création d’un potentiel d’action constant. Les dégradés d’acétylcholine sont recaptés par l’axone. Cette synapse neuro-musculaire est excitatrice uniquement (le potentiel d’action nerveux arrive puis il y a création d’un potentiel d’action musculaire). Cette transmission neuro-musculaire peut être bloquée par des substances pharmacologiques (curare qui se fixe sur des récepteurs spécifiques de l’acétylcholine sans création de potentiel d’action).
3-3 : COUPLAGE EXCITATION-CONTRACTION :
Le potentiel d’action musculaire progresse des deux cotés de la plaque motrice en surface grâce au sarcolème et en profondeur grâce aux tubules transverses. Les tubules T conduisent le potentiel d’action jusqu’aux citernes terminales du réticulum sarcoplasmique. Au niveau des tubules T, il y a des récepteurs aux dihydropyridines (récepteurs potentiels dépendant des activités par le potentiel d’action). A proximité des citernes terminales du réticulum plasmique, sur ce dernier, il y a des canaux calciques, récepteurs à la ryanodine. L’arrivée d’un potentiel d’action au niveau de la triade ouvre les canaux calciques qui libèrent le calcium. Le calcium libéré pénètre dans le sarcoplasme au niveau des myofibrilles. Le calcium se fixe sur la troponine des filaments fins (à la sous-unité C de la troponine). Ceci induit un glissement de la tropomyosine, qui permet la libération des sites de liaison de la myosine sur la molécule d’actine. Ensuite une liaison entre l’actine et la tête de myosine s’effectue.
3-4 : MECANISME DE CONTRACTION PAR GLISSEMENT DE FILAMENTS :
Lorsque la liaison actine-myosine a lieu, il y a activation de l’ATPase qui hydrolyse une molécule d’ATP en ADP + Phosphate. De l’énergie est alors libérée. Elle permet l’inclinaison des têtes de myosine. Au repos les têtes de myosine forment un angle de 90° avec le reste de la molécule. Après la libération de l’ATP, l’angle passe à 45°. Cette inclinaison tire sur les filaments fins. La contraction musculaire correspond au glissement des filaments fins vers le centre des sarcomères (zone H). Il y a donc un raccourcissement des sarcomères. Ce processus doit se réaliser plusieurs fois pour traduire une contraction musculaire
Après le tirage, une nouvelle molécule d’ATP se fixe ce qui induit une rupture de liaison actine-myosine. Une nouvelle liaison peut se faire, ce qui accroît le décalage (si le filament fin n’est pas revenu à sa place) jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de calcium. La longueur des différents filaments fins ne change pas seul leur chevauchement change (la zone H est de plus en plus petite). La largeur de la bande A (sombre) reste identique. La bande I (claire) diminue au fur et à mesure que les filaments fins se rapprochent. La bande H peut disparaître. Les filaments peuvent aller l’un sous l’autre. La bande H sera remplacée par la bande plus sombre. Les bandes I peuvent disparaître à l’issu d’un chevauchement total correspondant à 65% de la longueur initiale.
La zone H peut augmenter si les filaments fins s’étirent.
3-5 : RELAXATION :
Lorsque le potentiel d’action disparaît et que l’acétylcholine est dégradée (plus de possibilité de potentiel d’action), il y a une inactivation des canaux calciques du réticulum plasmique. Il n’y a plus de calcium libéré. De plus, le réticulum plasmique possède des pompes capables de recapter le calcium (pompe calcium-ATPase). Ces pompes recaptent le calcium, qui retournent dans le réticulum sarcoplasmique. Il n’y a plus de calcium lié à la tropomyosine. La tropomyosine se replace et masque les sites de liaison. Chez un organisme mort, il n’y a plus de synthèse d’ATP, donc plus de pompage du calcium et donc plus de rupture actine-myosine. Ce phénomène explique la rigidité cadavérique.